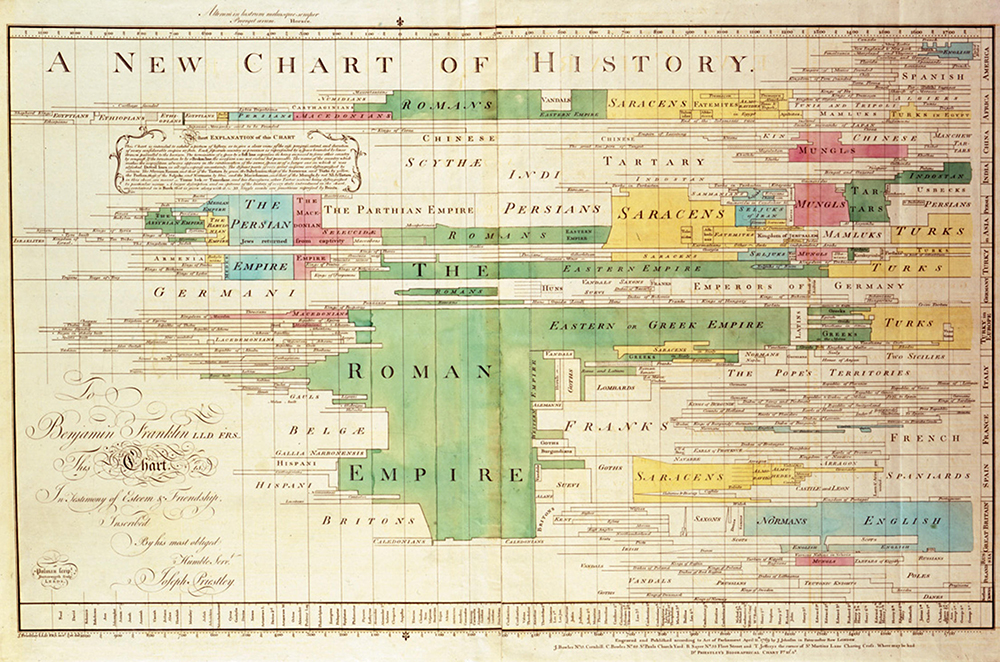L’Empire byzantin a existé de 330 à 1453. On l’appelle souvent Empire romain d’Orient ou simplement Byzance. La capitale byzantine fut fondée à Constantinople par Constantin Ier (r. 306-337). L’Empire byzantin a varié en taille au fil des siècles, à un moment ou à un autre, possédant des territoires situés en Italie, en Grèce, dans les Balkans, au Levant, en Asie Mineure et en Afrique du Nord.
Byzance était un État chrétien avec le grec comme langue officielle. Les Byzantins ont développé leurs propres systèmes politiques, pratiques religieuses, art et architecture. Celles-ci étaient toutes significativement influencées par la tradition culturelle gréco-romaine, mais étaient également distinctes et ne constituaient pas simplement une continuation de la Rome antique. L’Empire byzantin fut la puissance médiévale la plus ancienne et son influence perdure aujourd’hui, en particulier dans la religion, l’art, l’architecture et les lois de nombreux États occidentaux, d’Europe centrale et orientale et de Russie.
Le nom « byzantin » et les dates
Le nom « Byzantin » a été inventé par des historiens du XVIe siècle sur la base du fait que le prénom de la capitale était Byzance avant de devenir Constantinople (Istanbul moderne). C’était et continue d’être une étiquette loin d’être parfaite mais pratique qui différencie l’Empire romain d’Orient de l’Empire romain d’Occident, particulièrement importante après la chute de ce dernier au 5ème siècle. En effet, pour cette raison, il n’existe pas d’accord universel parmi les historiens sur la période à laquelle le terme « Empire byzantin » fait réellement référence. Certains érudits sélectionnent 330 et la fondation de Constantinople, d’autres la chute de l’Empire romain d’Occident en 476, d’autres encore préfèrent l’échec de Justinien Ier (r. 527-565) à unifier les deux empires en 565, et certains préfèrent même c . 650 et la conquête arabe des provinces orientales de Byzance. La plupart des historiens conviennent que l’Empire byzantin a pris fin le mardi 29 mai 1453, lorsque le sultan ottoman Mehmed II (r. 1444-6 et 1451-81) a conquis Constantinople.
La discussion sur les dates met également en évidence les différences dans le mélange ethnique et culturel entre les deux moitiés du monde romain et la distinction de l’État médiéval par rapport à son héritage romain antérieur. Les Byzantins s’appelaient eux-mêmes « Romains », leur empereur était basileon ton Rhomaion ou « Empereur des Romains » et leur capitale était « Nouvelle Rome ». Cependant, la langue la plus courante était le grec, et il est juste de dire que pendant la grande majorité de son histoire, l’Empire byzantin était beaucoup plus grec que romain en termes culturels.
Constantinople
Les débuts de l’Empire byzantin résident dans la décision de l’empereur romain Constantin Ier de déplacer la capitale de l’Empire romain de Rome à Byzance le 11 mai 330. Le nom populaire de Constantinople ou « Ville de Constantin » a rapidement remplacé le choix officiel de l’empereur. « Nouvelle Rome ». La nouvelle capitale disposait d’un excellent port naturel sur l’entrée de la Corne d’Or et, à cheval sur la frontière entre l’Europe et l’Asie, pouvait contrôler le passage des navires à travers le Bosphore, de la mer Égée à la mer Noire, reliant ainsi un commerce lucratif entre l’ouest et l’est. Une grande chaîne s’étendait à l’entrée de la Corne d’Or, et la construction des murs massifs de Théodose entre 410 et 413 signifiait que la ville était capable de résister à maintes reprises à des attaques concertées de la mer et de la terre. Au fil des siècles, à mesure que des bâtiments plus spectaculaires étaient ajoutés, la ville cosmopolite est devenue l’une des plus belles de toutes les époques et certainement la ville chrétienne la plus riche, la plus somptueuse et la plus importante du monde.
Empereurs byzantins
L’empereur byzantin ou basileus (ou plus rarement basilissa pour impératrice) résidait dans le magnifique Grand Palais de Constantinople et régnait en monarque absolu sur un vaste empire. En tant que tel, le basileus avait besoin de l’aide d’un gouvernement expert et d’une bureaucratie étendue et efficace. Bien qu’il soit un dirigeant absolu, un empereur était censé – de la part de son gouvernement, de son peuple et de l’Église – gouverner avec sagesse et justice. Plus important encore, un empereur devait connaître des succès militaires, car l’armée restait l’institution la plus puissante de Byzance en termes réels. Les généraux de Constantinople et des provinces pouvaient – et ils le faisaient – destituer un empereur qui ne parvenait pas à défendre les frontières de l’empire ou qui provoquait une catastrophe économique. Pourtant, dans le cours normal des événements, l’empereur était commandant en chef de l’armée, chef de l’Église et du gouvernement, il contrôlait les finances de l’État et nommait ou révoquait les nobles à volonté ; Peu de dirigeants, avant ou depuis, ont exercé un tel pouvoir.
Gouvernement byzantin
Le gouvernement byzantin a suivi les modèles établis dans la Rome impériale. L’empereur était tout-puissant mais devait néanmoins consulter des organes aussi importants que le Sénat. Le Sénat de Constantinople, contrairement à celui de Rome, était composé d’hommes ayant gravi les échelons du service militaire et il n’y avait donc pas de classe sénatoriale en tant que telle. Sans élections, les sénateurs, ministres et conseillers locaux byzantins ont largement acquis leur position grâce au patronage impérial ou en raison de leur statut de grands propriétaires fonciers.
Justinien Ier
Justinien Ier
Parrainé par un banquier grec, Julius Argentarius (CC BY-NC-SA)
Les sénateurs d’élite constituaient le petit consistorium sacré que l’empereur était, en théorie, censé consulter sur les questions d’importance nationale. En outre, l’empereur pouvait consulter les membres de son entourage personnel à la cour. À la cour se trouvaient également les chambellans eunuques (cubiculaires) qui servaient l’empereur dans diverses fonctions personnelles mais qui pouvaient également contrôler l’accès à lui. Les eunuques occupaient eux-mêmes des postes de responsabilité, au premier rang desquels le détenteur de la bourse de l’empereur, les sakellarios, dont les pouvoirs allaient s’accroître considérablement à partir du VIIe siècle. Parmi les autres responsables gouvernementaux importants figuraient le questeur ou le conseiller juridique en chef ; vient le sacrarum largitionum qui contrôlait la Monnaie de l’État ; le magister officiorum qui s’occupait de l’administration générale du palais, de l’armée et de ses approvisionnements, ainsi que des affaires étrangères ; et une équipe d’inspecteurs impériaux qui surveillaient les affaires des conseils locaux à travers l’empire.
Le plus haut fonctionnaire de Byzance, cependant, était le préfet prétorien de l’Est, devant lequel tous les gouverneurs régionaux de l’empire relevaient. Les gouverneurs régionaux supervisaient les conseils municipaux individuels ou curae. Les conseillers locaux étaient responsables de tous les services publics et de la perception des impôts dans leur ville et ses environs. Ces conseils étaient organisés géographiquement en une centaine de provinces elles-mêmes regroupées en 12 diocèses, trois dans chacune des quatre préfectures de l’empire. À partir du VIIe siècle, les gouverneurs régionaux des diocèses, ou thèmes comme on les appelait après une restructuration, devinrent en effet des commandants militaires provinciaux (strategoi) qui relevaient directement de l’empereur lui-même, et le préfet du prétoire fut aboli. Après le VIIIe siècle, l’administration de l’empire, en raison de la menace militaire croissante des voisins et des guerres civiles internes, est devenue beaucoup plus simplifiée qu’auparavant.
Corpus Juris Civilis
Le gouvernement byzantin a été grandement aidé par la création du Code Justinien ou Corpus Juris Civilis (Corpus de droit civil) par Justinien Ier. Le corpus, rédigé par un groupe d’experts juridiques, a rassemblé, édité et révisé l’immense corpus des lois romaines. qui s’étaient accumulés au fil des siècles – un nombre massif d’édits impériaux, d’avis juridiques et de listes de crimes et de châtiments. Le code, composé de plus d’un million de mots, durerait 900 ans, rendrait les lois plus claires pour tous, réduirait le nombre d’affaires inutilement portées devant les tribunaux, accélérerait le processus judiciaire et influencerait par la suite la plupart des systèmes juridiques des démocraties occidentales.
Société byzantine
Les Byzantins accordaient une grande importance au nom de famille, à la richesse héritée et à la naissance respectable d’un individu. Les individus des niveaux supérieurs de la société possédaient ces trois choses. La richesse provenait de la propriété foncière ou de l’administration des terres sous la juridiction d’un administrateur individuel. Cependant, il n’existait pas d’aristocratie de sang en tant que telle dans la société byzantine, et le patronage et l’éducation étaient tous deux un moyen de gravir l’échelle sociale. En outre, l’octroi de faveurs, de terres et de titres par les empereurs, ainsi que les rétrogradations aveugles et les risques d’invasions étrangères et de guerres, signifiaient que les composantes individuelles de la noblesse n’étaient pas statiques et que les familles montaient et descendaient au fil des siècles. Le rang était visible à tous les membres de la société grâce à l’utilisation de titres, de sceaux, d’insignes, de vêtements particuliers et de bijoux personnels.
Gouvernement byzantin
Le gouvernement byzantin a suivi les modèles établis dans la Rome impériale. L’empereur était tout-puissant mais devait néanmoins consulter des organes aussi importants que le Sénat. Le Sénat de Constantinople, contrairement à celui de Rome, était composé d’hommes ayant gravi les échelons du service militaire et il n’y avait donc pas de classe sénatoriale en tant que telle. Sans élections, les sénateurs, ministres et conseillers locaux byzantins ont largement acquis leur position grâce au patronage impérial ou en raison de leur statut de grands propriétaires fonciers.
Justinien Ier
Justinien Ier
Parrainé par un banquier grec, Julius Argentarius (CC BY-NC-SA)
Les sénateurs d’élite constituaient le petit consistorium sacré que l’empereur était, en théorie, censé consulter sur les questions d’importance nationale. En outre, l’empereur pouvait consulter les membres de son entourage personnel à la cour. À la cour se trouvaient également les chambellans eunuques (cubiculaires) qui servaient l’empereur dans diverses fonctions personnelles mais qui pouvaient également contrôler l’accès à lui. Les eunuques occupaient eux-mêmes des postes de responsabilité, au premier rang desquels le détenteur de la bourse de l’empereur, les sakellarios, dont les pouvoirs allaient s’accroître considérablement à partir du VIIe siècle. Parmi les autres responsables gouvernementaux importants figuraient le questeur ou le conseiller juridique en chef ; vient le sacrarum largitionum qui contrôlait la Monnaie de l’État ; le magister officiorum qui s’occupait de l’administration générale du palais, de l’armée et de ses approvisionnements, ainsi que des affaires étrangères ; et une équipe d’inspecteurs impériaux qui surveillaient les affaires des conseils locaux à travers l’empire.
Le plus haut fonctionnaire de Byzance, cependant, était le préfet prétorien de l’Est, devant lequel tous les gouverneurs régionaux de l’empire relevaient. Les gouverneurs régionaux supervisaient les conseils municipaux individuels ou curae. Les conseillers locaux étaient responsables de tous les services publics et de la perception des impôts dans leur ville et ses environs. Ces conseils étaient organisés géographiquement en une centaine de provinces elles-mêmes regroupées en 12 diocèses, trois dans chacune des quatre préfectures de l’empire. À partir du VIIe siècle, les gouverneurs régionaux des diocèses, ou thèmes comme on les appelait après une restructuration, devinrent en effet des commandants militaires provinciaux (strategoi) qui relevaient directement de l’empereur lui-même, et le préfet du prétoire fut aboli. Après le VIIIe siècle, l’administration de l’empire, en raison de la menace militaire croissante des voisins et des guerres civiles internes, est devenue beaucoup plus simplifiée qu’auparavant.
Corpus Juris Civilis
Le gouvernement byzantin a été grandement aidé par la création du Code Justinien ou Corpus Juris Civilis (Corpus de droit civil) par Justinien Ier. Le corpus, rédigé par un groupe d’experts juridiques, a rassemblé, édité et révisé l’immense corpus des lois romaines. qui s’étaient accumulés au fil des siècles – un nombre massif d’édits impériaux, d’avis juridiques et de listes de crimes et de châtiments. Le code, composé de plus d’un million de mots, durerait 900 ans, rendrait les lois plus claires pour tous, réduirait le nombre d’affaires inutilement portées devant les tribunaux, accélérerait le processus judiciaire et influencerait par la suite la plupart des systèmes juridiques des démocraties occidentales.
Société byzantine
Les Byzantins accordaient une grande importance au nom de famille, à la richesse héritée et à la naissance respectable d’un individu. Les individus des niveaux supérieurs de la société possédaient ces trois choses. La richesse provenait de la propriété foncière ou de l’administration des terres sous la juridiction d’un administrateur individuel. Cependant, il n’existait pas d’aristocratie de sang en tant que telle dans la société byzantine, et le patronage et l’éducation étaient tous deux un moyen de gravir l’échelle sociale. En outre, l’octroi de faveurs, de terres et de titres par les empereurs, ainsi que les rétrogradations aveugles et les risques d’invasions étrangères et de guerres, signifiaient que les composantes individuelles de la noblesse n’étaient pas statiques et que les familles montaient et descendaient au fil des siècles. Le rang était visible à tous les membres de la société grâce à l’utilisation de titres, de sceaux, d’insignes, de vêtements particuliers et de bijoux personnels.
La plupart des membres des classes inférieures auraient exercé la profession de leurs parents, mais l’héritage, l’accumulation de richesses et l’absence de toute interdiction formelle pour une classe de passer à une autre offraient au moins une petite possibilité à une personne d’améliorer sa situation sociale. position. Il y avait des travailleurs occupant de meilleurs emplois, comme ceux qui travaillaient dans les affaires juridiques, l’administration et le commerce (un moyen peu apprécié de gagner sa vie pour les Byzantins). À l’échelon suivant se trouvaient les artisans, puis les agriculteurs qui possédaient leurs propres petites parcelles de terre, puis le groupe le plus important – ceux qui travaillaient la terre des autres, et enfin, les esclaves qui étaient généralement des prisonniers de guerre mais loin d’être aussi nombreux que les travailleurs libres. .
Le rôle des femmes byzantines, comme celui des hommes, dépendait de leur rang social. Les femmes aristocratiques étaient censées gérer la maison et s’occuper des enfants. Bien qu’elles puissent posséder des biens, elles ne pouvaient pas occuper de fonctions publiques et passaient leur temps libre à tisser, faire du shopping, aller à l’église ou lire (bien qu’elles n’aient eu aucune éducation formelle). Les veuves devenaient tutrices de leurs enfants et pouvaient hériter à parts égales avec leurs frères. De nombreuses femmes travaillaient, comme les hommes, dans l’agriculture et dans diverses industries manufacturières et services alimentaires. Les femmes pouvaient posséder leurs propres terres et entreprises, et certaines auraient amélioré leur position sociale grâce au mariage. Les professions les moins respectées étaient, comme ailleurs, celles des prostituées et des actrices.
Territoires de l’Empire byzantin
L’étendue géographique de l’Empire byzantin a changé au fil des siècles, à mesure que les succès et les échecs militaires des empereurs individuels fluctuaient. Les territoires détenus au début de l’histoire de l’empire comprenaient l’Égypte, la Syrie, la Jordanie, le Liban et la Palestine. La Grèce était moins importante en termes pratiques qu’en tant que symbole de la vision byzantine d’eux-mêmes comme véritables héritiers de la culture gréco-romaine. L’Italie et la Sicile durent être défendues, sans succès, contre les ambitions des papes et des Normands. Les Balkans jusqu’au Danube étaient importants partout, et l’Asie Mineure jusqu’à la côte de la mer Noire au nord et l’Arménie à l’est étaient une source majeure de richesse, mais ces deux régions nécessiteraient une défense régulière et vigoureuse contre divers ennemis éternels.
Alors que la carte politique était constamment redessinée avec la montée et la chute des empires voisins, des événements notables comprenaient Anastasios I (491-518) qui défendit avec succès l’empire contre les Perses et les Bulgares. Justinien Ier, aidé par son talentueux général Bélisaire (vers 500-565), reconquit les territoires d’Afrique du Nord, d’Espagne et d’Italie qui avaient été perdus par les empereurs occidentaux. Les Lombards en Italie et les Slaves dans les Balkans ont fait des incursions dans l’Empire au cours de la seconde moitié du VIe siècle, une situation finalement inversée par Héraclius (r. 610-641), mettant effectivement fin à l’Empire perse sassanide avec sa victoire. à Ninive en 627.
Les conquêtes islamiques des VIIe et VIIIe siècles prirent l’Empire de ses territoires au Levant (dont Jérusalem en 637), en Afrique du Nord et en Asie Mineure orientale. Au moins, cependant, l’Empire est resté ferme comme rempart contre l’expansion arabe en Europe, Constantinople résistant à deux reprises à des sièges arabes déterminés (674-8 et 717-18). L’Empire byzantin fut cependant ébranlé dans ses fondations. Puis, au IXe siècle, les Bulgares firent d’importantes incursions dans les régions du nord de l’Empire. Une résurgence de la fortune byzantine s’est produite avec la dynastie macédonienne (au nom inapproprié) (867-1057). Le fondateur de la dynastie, Basile Ier (r. 867-886), reconquit le sud de l’Italie, s’occupa des pirates crétois gênants et remporta des victoires contre les Arabes à Chypre, en Grèce continentale et en Dalmatie. Le tout prochain empereur, Léon VI (r. 886-912), perdit la plupart des gains, mais le milieu du Xe siècle fut marqué par des victoires dans la Mésopotamie sous contrôle musulman.
Basile II (r. 976-1025), connu sous le nom de « Tueur de Bulgares » pour ses victoires dans les Balkans, a supervisé une autre reprise surprenante de la fortune byzantine. Basile, aidé par une armée de féroces guerriers d’origine viking de Kiev, remporta également des victoires en Grèce, en Arménie, en Géorgie et en Syrie, doublant ainsi la taille de l’Empire. Ce fut cependant le dernier grand hourra alors qu’un déclin progressif s’installait. Après la défaite choquante face aux Seldjoukides à la bataille de Manzikert en Arménie en 1071, une brève renaissance se produisit sous Alexios I Comnène (r. 1081-1118) avec des victoires contre les Normands en Dalmatie, les Petchenègues en Thrace et les Seldjoukides en Palestine et en Syrie (avec l’aide des premiers croisés), mais il semblait y avoir trop d’ennemis dans trop de régions pour que les Byzantins prospèrent indéfiniment.
Aux XIIe et XIIIe siècles, le Sultanat de Roum s’empare de la moitié de l’Asie Mineure, puis le désastre survient lorsque les armées de la Quatrième Croisade saccagent Constantinople en 1204. Découpé entre Venise et ses alliés, l’Empire n’existe qu’en exil avant une restauration en 1261. Au 14ème siècle, l’Empire se composait d’une petite zone à la pointe du sud de la Grèce et d’une partie du territoire autour de la capitale. Le coup final fut, comme déjà mentionné, avec le sac de Constantinople par les Ottomans en 1453.
L’église byzantine
Le paganisme a continué à être pratiqué pendant des siècles après la fondation de Byzance, mais c’est le christianisme qui est devenu la caractéristique déterminante de la culture byzantine, affectant profondément sa politique, ses relations extérieures, son art et son architecture. L’Église était dirigée par le patriarche ou évêque de Constantinople, nommé ou révoqué par l’empereur. Les évêques locaux, qui présidaient les grandes villes et leurs territoires environnants et qui représentaient à la fois l’Église et l’empereur, disposaient d’une richesse et de pouvoirs considérables dans leurs communautés locales. Le christianisme est alors devenu un dénominateur commun important qui a contribué à lier diverses cultures en un seul empire qui comprenait les chrétiens grecs, arméniens, slaves, géorgiens et de nombreuses autres minorités, ainsi que ceux d’autres confessions telles que les juifs et les musulmans qui étaient autorisés à librement circuler. pratiquer leur religion.
Icône de Saint Basile
Icône de Saint Basile
Artiste inconnu (domaine public)
Les différences entre l’Église orientale et occidentale étaient l’une des raisons pour lesquelles l’Empire byzantin était si peu représenté dans les histoires médiévales occidentales. Les Byzantins étaient souvent décrits comme décadents et sournois, leur culture stagnante et leur religion une dangereuse hérésie. Les Églises de l’Est et de l’Ouest étaient en désaccord sur la question de savoir qui devait avoir la priorité : le Pape ou le Patriarche de Constantinople. Des questions de doctrine ont également été contestées, comme la question de savoir si Jésus-Christ avait une nature humaine et une nature divine combinées ou simplement une nature divine. Le célibat clérical, l’utilisation du pain au levain ou sans levain, le langage du service et l’utilisation de l’imagerie étaient autant de points de différences qui, avec le carburant des ambitions politiques et territoriales ajoutés au mélange volatil d’émotions, ont conduit au schisme de l’Église. de 1054.
Architecture byzantine
Les architectes byzantins ont continué à utiliser les ordres classiques dans leurs bâtiments et ont emprunté des idées au Proche-Orient, entre autres. Les conceptions sont devenues plus éclectiques que dans l’Antiquité, notamment en raison de l’habitude commune de réutiliser les matériaux des bâtiments plus anciens pour de nouvelles structures. Il y avait aussi un accent marqué sur la fonction plutôt que sur la forme et une plus grande préoccupation pour l’intérieur plutôt que pour l’extérieur des bâtiments. Continuant à construire des structures typiquement romaines telles que des aqueducs voûtés, des amphithéâtres, des hippodromes, des bains et des villas, les Byzantins ajoutèrent au répertoire avec leurs églises à dôme, leurs monastères fortifiés et leurs murs de fortification plus sophistiqués.
Les matériaux de construction privilégiés étaient les grosses briques avec du mortier et du béton pour le noyau caché des murs. Les blocs de pierre de taille étaient utilisés dans les édifices publics plus prestigieux tandis que le marbre, utilisé avec plus de parcimonie qu’à l’époque romaine antérieure, était généralement réservé aux colonnes, aux encadrements de portes et de fenêtres et à d’autres éléments décoratifs. Les toits étaient en bois tandis que les murs intérieurs étaient fréquemment recouverts de plâtre, de stuc, de fines plaques de marbre, de peintures et de mosaïques.
L’édifice byzantin le plus grand, le plus important et encore le plus célèbre est la basilique Sainte-Sophie de Constantinople, dédiée à la sainte sagesse (hagia sophia) de Dieu. Construit de nouveau en 532-537, sa forme rectangulaire de base mesure 74,6 x 69,7 mètres (245 x 229 pieds) et son immense plafond en forme de dôme s’élève à 55 mètres au-dessus du sol et s’étend sur 31,8 mètres de diamètre. Reposant sur quatre arcs massifs soutenus par quatre pendentifs, le dôme était une réalisation architecturale spectaculaire pour l’époque. Sainte-Sophie est restée la plus grande église du monde jusqu’au XVIe siècle et l’une des plus décorées de superbes mosaïques scintillantes et de peintures murales.
Les églises chrétiennes, en général, furent l’une des plus grandes contributions byzantines à l’architecture, en particulier l’utilisation du dôme. Le plan en croix est devenu le plus courant avec le dôme construit sur quatre arcs de support. La base carrée du bâtiment se divisait ensuite en baies qui pouvaient elles-mêmes avoir un plafond en demi-dôme ou en dôme complet. Une autre caractéristique commune est une abside centrale avec deux absides latérales à l’extrémité est de l’église. Au fil du temps, le dôme central a été élevé de plus en plus haut sur un tambour polygonal qui, dans certaines églises, est si haut qu’il ressemble à une tour. De nombreuses églises, notamment les basiliques, avaient à côté d’elles un baptistère (généralement octogonal), et parfois un mausolée pour le fondateur de l’église et ses descendants. De telles caractéristiques de conception byzantines allaient influencer l’architecture chrétienne orthodoxe et sont donc encore visibles aujourd’hui dans les églises du monde entier.